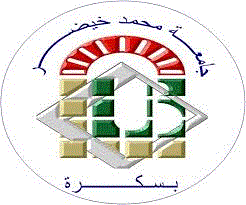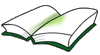|
Résumé :
|
L'arbre n'est pas citadin depuis toujours. Longtemps, les villes en étaient dépourvues ou s'en tenaient à l'arbre unique des places. Quand Sully ordonne la plantation d'ormes dans les villages et le long des grands chemins, c'est d'abord parce que leur bois est indispensable aux charrons et aux arsenaux. La République se fera la principale propagatrice de l'arbre urbain et d'alignement. Il en résulte un patrimoine vivant qui, s'il n'est pas toujours perçu comme tel, accorde nos regards aux saisons, accompagne nos rêveries d'un assentiment tranquille, apaise, émeut sans qu'on sache forcément pourquoi. Et pourtant, l'arbre des villes n'a pas encore trouvé de statut bien défini. Est-il une extension du “mobilier urbain”, un élément de décor désormais reconnu comme indispensable ? Représente-t-il l'avènement de “la nature dans la ville”, attestant quelque souci d'intégration de l'une à l'autre ? L'arbre, en ville, atteste déjà les capacités exceptionnelles de la flore à l'adaptation dans des milieux a priori défavorables. À la différence des plantes qui sont en passe de convertir la ville en vitrine de jardinerie, les grands ligneux doivent se perpétuer durant des décennies en des conditions de croissance très éloignées de celles de l'habitat d'origine. Qu'y a-t-il de moins “naturel” qu'un trottoir? Qu'en est-il de la respiration des feuilles dans une atmosphère aussi peu forestière que celle d'un boulevard ? Et pense-t-on à ce que les Temps Modernes ont choisi d'ignorer : l'inverse de l'arbre visible, le domaine des racines qui, en ville, explorent un sous-sol douteux ? Caroline Mollie en sait beaucoup sur l'arbre urbain, qu'elle a longtemps côtoyé durant sa carrière d'architecte-paysagiste. Son ouvrage, soutenu par une illustration aussi pertinente que superbe, où le passé fournit de nombreux repères, décrit, explique, compare les divers emplois des grands ligneux dans les multiples variantes de l'espace citadin. Mais ce traité “d'urbanisme végétal” en forme de manuel
|