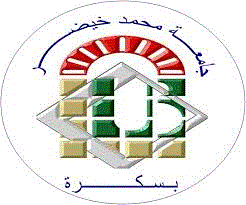| Titre : | Étude de croissance de créatures artificielles résilientes |
| Auteurs : | Djouher Akrour, Auteur ; Noureddine Djedi, Directeur de thèse ; Hervé Luga, Directeur de thèse |
| Type de document : | Thése doctorat |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2020 |
| Format : | 1 vol. (113 p.) / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Robotique évolutionnaire,Robots modulaires,Résilience,Réalisme,Contrôle,Apprentissage. |
| Résumé : |
Pour être totalement autonomes, les robots doivent être résilients pour pouvoir se remettre des dommages et fonctionner pendant une longue période sans assistance humaine. La robotique évolutionnaire aspire à atteindre cet objectif en se reposant sur les algorithmes évolutionnaires afin d’évoluer conjointement les corps et les contrôleurs des robots. Dans cette thèse, nous décrivons deux contributions pour la conception automatique des créatures robotiques virtuelles. Dans un premier temps, nous nous intéressons à l’aspect réalisme des simulations. Pour cela, nous proposons une approche qui permet de générer automatiquement des robots modulaires réalistes en s’appuyant sur un simulateur crédible de robotique. Nous démontrons la capacité de notre modèle à générer une variété de robots capables de se comporter de manière réaliste. En fait, le comportement global d’un robot se fait par la synergie produite par la coopération des modules le composant. Ainsi, il peut réaliser des locomotions intéressantes tout en parcourant une longue distance. Dans une deuxième étape, nous avons proposé une nouvelle approche pour permettre aux robots d’acquérir des capacités de résilience. Nous montrons que lorsque les robots sont délibérément confrontés à des pannes durant le temps d’apprentissage, le processus d’évolution permet d’optimiser et de générer des robots adaptables dont le comportement est moins affecté par les dommages. |
| Sommaire : |
Table des figures V Liste des tableaux VIII 1 Introduction générale 1 1.1 Contexte et motivations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 Problématique et objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.3 Contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.4 Structure de la thèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 La robotique évolutionnaire 6 2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.2 Rappel sur l’évolution artificielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.2.1 Les algorithmes évolutionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.2.2 Le multi-objectif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.3 L’évolution des créatures artificielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.3.1 Créatures artificielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.3.2 Travaux de références . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.3.3 Importance de la morphologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.4 La résilience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.5 Défis de la robotique évolutionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.5.1 Convergence prématurée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.6 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3 Robotique modulaire 28 3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.2 Les robots modulaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.3 Les types des robots modulaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.4 Les modèles proposés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.4.1 Les robots modulaires auto-reconfigurables . . . . . . . . . . . 31 3.4.2 Les robots modulaires manuellement reconfigurables . . . . . . 35 3.5 Étude comparative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.6 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4 Simulateurs robotiques 41 4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4.2 Description des simulateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4.2.1 Le moteur physique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.2.2 Gazebo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 4.2.3 MORSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4.3 Comparaison entre MORSE et Gazebo . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 4.4 Choix du simulateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 4.5 Reality Gap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 4.6 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 Le modèle proposé 53 5.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 5.2 Le robot modulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 5.2.1 La morphologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 5.2.2 Le système de contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 5.3 L’évolution jointe de robots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 5.3.1 Les opérateurs génétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 5.4 L’environnement de simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5.4.1 Gazebo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5.4.2 Les capteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 5.4.3 Problèmes rencontrés par rapport à Gazebo . . . . . . . . . . 63 5.5 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 6 Expérimentations et résultats 70 6.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 6.2 Évolution jointe des contrôleurs et des morphologies pour des robots réalistes . . . . 70 6.2.1 Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 6.2.2 Objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 6.2.3 La fonction d’évaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 6.2.4 Paramètres de l’étude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 6.2.5 Résultats expérimentaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 6.2.6 Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 6.3 Une approche évolutionnaire pour la génération de robots modulaires résilients . . . . 79 6.3.1 Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 6.3.2 Objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 6.3.3 La fonction d’évaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 6.3.4 Paramètres de l’étude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 6.3.5 Expérimentation et résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 6.3.6 Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 6.4 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 7 Évaluation du modèle 88 7.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 7.2 Récapitulatif des résultats obtenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 7.3 Validation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 7.3.1 Réalisme des créatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 7.3.2 Comportements développés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 7.3.3 Capacité de résilience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 7.4 Limitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 7.5 Bilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 7.6 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 8 Conclusion générale 97 8.1 Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 8.2 Perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Bibliographie 100 Acronyms 112 |
| En ligne : | http://thesis.univ-biskra.dz/4766/1/th%C3%A8se.pdf |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| TINF/143 | Théses de doctorat | bibliothèque sciences exactes | Consultable |